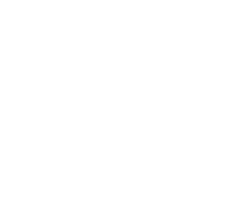Fiches de recettes de Charles Bergerand
Une belle trouvaille
« C’est en rangeant les affaires de ma mère, qui était antiquaire à Chablis, que j’ai découvert, glissées dans son livre de cuisine, ces fiches de recettes publiées par Charles Bergerand, propriétaire et chef de cuisine de l’HôteI de l’Etoile. Il en faisait cadeau à ses bons clients. On peut les dater des années 1930-40.
Avec crème, beurre et vins de Chablis, on s’adressait à des gourmands solides… »
Guillaume Dufour, membre fondateur de Chablis, terre d’histoire.

Coutumes chablisiennes
Dans un important et riche article intitulé «Les usages, croyances, traditions, superstition etc … ayant existé ou existant encore dans les divers pays du département de l’Yonne» publié en 1888 dans le numéro 42 du Bulletin de la société des sciences de l’Yonne, le savant avocat Charles Moiset rapporte quelques traditions qui concernent Chablis ; nous les retranscrivons ici telles quelles dans l’ordre du calendrier des fêtes :
Le carnaval
Au sujet du mannequin «Carnaval» que l’on poursuit dans les rues et que l’on brûle symboliquement le Mardi Gras, avant l’entrée en Carême :
«A Chablis, où Carnaval s’appelait Grégoire, on disait : «Où est Grégoire ?» Carnaval, de son côté, représenté par un mannequin en paille habillé, était roulé sur une charrette par une autre troupe de masques qui, pendant une heure ou deux, le dérobait aux chercheurs. Au bout de ce temps, on le laissait prendre. Alors on conduisait le maudit sur la place publique, où un tribunal se constituait parfois devant une potence, et instruisait son procès dans les formes. Dès ce moment, le pauvre Carnaval devenait le bouc émissaire de tous les péchés….
A Chablis, il y a trente ans, l’exécution de Grégoire était l’occasion d’une belle fête carnavalesque à laquelle assistaient les habitants des Communes environnantes. On faisait une partie illuminée et, pour couronnement, des entrailles de Grégoire partait un brillant feu d’artifice»
La «roulée» des oeufs de Pâques
Un drôle de jeu avec les œufs de Pâques.
Le lundi suivant la fête, «on faisait rouler sur un plan incliné, des œufs qui, avant de s’arrêter, devaient s’entrechoquer avec d’autres placés au repos et servant de but… En certains endroits (Saint-Florentin, Quarré-les-Tombes, Chablis), enfants et même grandes personnes jouaient, il n’y a pas longtemps encore, à la toquette avec des roulées. L’un des joueurs présentait à l’autre l’extrémité d’un œuf enveloppé le plus possible dans la main. L’adversaire devait frapper son œuf du même bout. L’œuf cassé était acquis au partenaire dont l’œuf avait résisté au choc.
A Chablis, quand un joueur malheureux avait épuisé sa provision, il payait une petite redevance et obtenait la permission de changer de « bout »
Les feux de la Saint-Jean
«A Chablis, les feux de la Saint-Jean ont pour objet de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. Dans chaque quartier on prépare autant de feux qu’il s’y trouve de nouveaux venus. Le soir, les plus vieux du quartier vont, munis de torches de glue enrubannées et fleuries, inviter les nouveaux résidents à allumer les bûchers dressés en leur honneur. Si ce sont des dames, on leur offre les bras pour les conduire au bûcher. Quand le feu est allumé, on lance des pétards dans le foyer, on danse en ronde autour ; puis, le bois consumé, les vieilles femmes ramassent la braise et la conservent comme un préservatif contre la foudre et les épidémies. Ceux qui ont allumé les feux invitent toutes les personnes qui ont assisté à la cérémonie, et même les passants, à aller s’assoir à des tables chargées de rafraîchissements, qu’ils ont fait établir devant leur porte. On boit, on chante et la fête se prolonge jusqu’à minuit».
LES VENDANGES
«A Chablis, il y a peu de temps encore, le dernier marc que l’on faisait dans un pressoir était célébré par un redoublement de réjouissances et de bombances. Pendant le repas, les pressureurs chantaient à pleine gorge en frappant avec les chevilles de la roue sur la table ou sur des tonnes. Puis ils promenaient triomphalement dans les rues soit le maître du pressoir, soit l’un d’eux trônant sur une tinne que l’on portait sur les épaules, de même que pour le transport du vin. La procession se faisait au milieu de chants et de bruits produits par des coups frappés sur un objet sonore. Pour terminer, on offrait un énorme bouquet au maître du pressoir. Ce bouquet était planté au-dessus de la porte du pressoir, où il restait jusqu’à l’année suivante.
LES CONSCRITS
«A Beines, il existe sur le bord de la route, un vieil orme qui sert à la pratique d’une vieille coutume assez bizarre. Lorsque, chaque année, partaient les conscrits de Chablis, leurs camarades et les jeunes gens de la conscription suivante les accompagnaient, tambour en tête et en chantant, jusqu’à Beines, qui est à six kilomètres. Arrivés devant l’orme, la troupe s’arrêtait : chacun des conscrits plantait dans l’arbre un clou qu’il avait fait fabriquer et qui, souvent, portait son nom.
Après quoi on buvait la dernière bouteille, on se donnait la dernière accolade, et l’on se séparait.
(…) La plupart des conscrits se rendant aujourd’hui en voiture à Auxerre, la reconduite ne se fait plus jusqu’à Beines, mais seulement jusqu’à l’extrémité du pont de Chablis».

L’hôtel de l’Etoile Bergerand à Chablis
Le célèbre hôtel-restaurant de l’Etoile à Chablis connut ses heures de gloire dans la première moitié du XXème siècle. De nombreuses personnalités l’ont fréquenté et ont apprécié la cuisine exceptionnelle du maître queux Charles Bergerand.
La famille Bergerand : Originaire de Saint- Romans dans l’Isère où, avant 1700, les ancêtres de Charles étaient menuisiers, l’un d’entre eux se marie en 1789 avec une fille
de Trucy-sur-Yonne et s’y installe comme menuisier. Leur fils suivra la lignée professionnelle comme menuisier à Auxerre.
Théodore Bergerand, né en 1818 à Auxerre, rompt avec la tradition familiale et va apprendre le métier de cuisinier à Paris. Après quelques années d’apprentissage, on le
retrouve vers 1851 maître saucier aux cuisines du roi Louis-Philippe aux Tuileries. Installé à Chablis en 1866 dans un ancien hôtel de poste, il épouse la fille d’un commissionnaire en vins. Leur fils Charles né en 1853 devient maître d’hôtel à Chablis en 1870.
Il a à son tour un fils né en 1879, prénommé Charles comme son père. A sa sortie de l’école en 1896 il est apprenti pâtissier, puis apprenti cuisinier à Beaune. Ensuite il fait ses
classes comme chef de cuisine dans de grands restaurants à Paris et à Monte Carlo, et reprend la maison familiale en 1906. Il développe considérablement la maison «Bergerand» et assure la grande notoriété de son restaurant. Il contribue également à rendre célèbres les vins de Chablis servis à sa table.
Les spécialités culinaires : Tout d’abord le très célèbre «jambon chaud mode d’ici», appelé plus tard le «jambon à la chablisienne», les escargots de Bourgogne, la
fondue de poulet à la crème, les écrevisses à la chablisienne, le soufflé aux oranges…
Premier prix du «bon hôtelier» du Touring Club de France en 1913, Charles Bergerand fait de son établissement l’une des principales étapes de la route gastronomique de France.
Le livre d’or : Aristide Briand, Pierre Fresnay, Jean Cocteau, Raimu, André Gide, Sacha Guitry, le roi d’Espagne Alphonse XIII… Et le président de la République Gaston
Doumergue qui, après avoir bu sans doute de grands chablis ajoute « Gastounet » sous sa signature !
Les bâtiments : situés à l’angle de la rue des Moulins et de la rue du Maréchal Leclerc, Ils ont leur issue sur le quai du Biez. La façade principale porte la date de 1778 ; dans les
caves sur une pierre est gravée celle de 1620. Différents bâtiments ont vraisemblablement été rassemblés, certains démolis au fil des siècles. Dans les communs, les plus anciens
bâtiments peuvent être datés du XVIe s. comme le prouvent des arcs en accolade et autres consoles supportant d’énormes poutres.
Le bâtiment principal appartenait en 1831 au notaire François Thomassin et en 1859 au notaire J. Baptiste Charlier.
Au début du XXème s. de nombreuses cartes postales montrant l’Hôtel Bergerand ont été éditées.
Charles Bergerand passe la main à André Roy (originaire de Fontenay-près Chablis) au début des années 1950. Charles Bergerand s’éteint à Chablis en 1954 sans descendance.
Après André Roy se sont succédés les époux Mahieu, puis M. et Mme Prévost. Enfin, Mme Nicole de Merteuil achète l’hôtel de l’Etoile en 2001.
Elle vient de le vendre en novembre 2022 à Céline et Frédéric Gueguen.
Après de gros travaux de rénovation, ce mythique hôtel-restaurant qui fait partie de l’histoire de Chablis, devrait à nouveau voir briller son étoile !
Auteur : Jean-Paul Droin, décembre 2022

Les courses vélocipédiques à Chablis
A Chablis, à la fin du 19ème siècle, la fête patronale de la Saint-Pierre était très prisée. Les festivités avaient lieu le dimanche et le lundi le plus proche du jour anniversaire du saint, les derniers jours de juin ou les premiers jours de juillet. Le lundi matin était réservé à une messe célébrée exceptionnellement dans l’église Saint-Pierre et l’après-midi consacré à diverses réjouissances au Pâtis pour tous ceux qui n’avaient pas « la gueule de bois » ; la veille ayant souvent été un peu chargée… Les ouvriers vignerons avaient droit traditionnellement à un jour chômé. Cette tradition perdura jusque dans les années 1960. La remise des prix des écoles était un moment particulièrement attendu par les élèves méritants ayant droit, en plus des célèbres livres à la couverture rouge de Robinson Crusoé ou des voyages de Gulliver offerts par la Ville, à des tours gratuits de chevaux de bois, remplacés bien plus tard par les autos-tamponneuses.
L’après-midi du dimanche 2 juillet 1893 fut consacré à quatre courses vélocipédiques, (comme l’on disait alors). Elles étaient organisées par la municipalité.
Les « machines de course » : La première course était réservée aux « machines » munies de « caoutchouc pleins et creux ». Si les premières ne craignaient pas la crevaison, on pouvait néanmoins douter d’un certain confort, le caleçon de l’époque n’amortissant pas la dureté de la selle sans ressorts de la « machine » …
Les épreuves étaient « courues sur un circuit formé de trois fractions de 600 mètres, formant triangle d’environ 600 mètres chaque fraction ».
Le parcours : le départ avait lieu au quartier de la Maladière, au pied des vignes des Clos, près du Château Grenouille. La course commençait au carrefour de la route de Maligny, puis empruntait à gauche la rue de l’Orme (ancienne rue des Tanneries, devenue aujourd’hui l’avenue Jean-Jaurès), longeait le pré de l’Orme (ancien terrain de camping) devenu le Parc de la Liberté. Au pont, tournait à gauche pour emprunter la chaussée Saint-Sébastien devenue par la suite l’avenue de la Maladière (l’avenue d’Oberwesel aujourd’hui), prenait à gauche pour longer la route au bas des vignes des Clos et arrivait enfin au point de départ.
Les prix attribués : Les vainqueurs se voyaient remettre plusieurs prix en argent, en bouteilles de Chablis ou de champagne et même en caisses de biscuits « Duché ».
Les lots en bouteilles de Chablis millésime 1884 prouvaient s’il le fallait encore que ce vin sélectionné vieux de neuf années était toujours reconnu pour sa longue conservation comme le précisait aux moines de Pontigny, le seigneur le Montréal en 1186.

Chablis en fête
A la fin du 19ème siècle, poussés par leur maire Jules Folliot, (il fut le président du conseil général de l’Yonne), les habitants de Chablis organisaient de grandes réjouissances le jour de la fête patronale de « la Saint-Pierre ». Pendant ces quelques jours de festivités, les vignerons chablisiens oubliaient les ravages du terrible insecte, le phylloxéra qui anéantissait inexorablement depuis quatre ans déjà toutes leurs vignes…
Le dimanche après-midi, la fête battait son plein. De nombreux chars tirés par des chevaux (d’où le nom de cavalcade) étaient pompeusement décorés. Chaque association ou quartier rivalisait d’imagination, d’ingéniosité, et, c’est à qui ferait le plus beau, le plus haut, le plus remarqué.
1 siècle après la Révolution française, la cavalcade du 30 juin 1889 dépassa toutes les autres, en particulier et pour cause, le char de la tour Eiffel, réplique un peu moins haute que celle inaugurée exactement 4 mois plus tôt à Paris sur le Champ de Mars lors de l’exposition universelle. La tour chablisienne dépassait quand même les 20 mètres, un immeuble de six étages ! un seul cheval tirait l’ensemble.
Après avoir emprunté de nombreuses rues de la cité, les chars finissaient leur parcours au Pâtis où le cortège se disloquait près du jeu de paume fréquenté par de nombreux chablisiens.
En soirée, une grande fête avait lieu avec bal, illuminations et une farandole aux flambeaux animée par les figurants de la cavalcade, revêtus de leurs costumes couronnait le tout.
Deux trains supplémentaires de nuit permettaient à tous les participants de la vallée du Serein de pouvoir faire la fête jusqu’à plus de minuit et pour ne pas « louper le tacot », une salve d’artillerie était tirée au Pâtis vingt minutes avant le départ de chaque train ! Malgré ces avertissements, beaucoup sans doute rentraient à pied chez eux « au p’tit jour… »
Commentaire sur la photo de la cavalcade en 1889 :
Il n’y avait pas encore le monument aux Morts sur la place.
A l’arrière-plan, derrière les chars, à gauche, on aperçoit la maison du maire Jules Folliot, décorée de nombreux drapeaux tricolores. Au centre, on devine l’ancienne biscuiterie Mottot. On imagine la hauteur et la solidité de la tour Eiffel au nombre des personnes juchées jusqu’à 10 mètres au-dessus du sol. Elle était tirée par un seul cheval, on aperçoit les limons posés sur le sol.
Le char de la musique est au centre. On devine sur le devant du char « Les Enfants de Chablis ». On aperçoit en haut une lyre. Le char byzantin reconnaissable par ses coupoles caractéristiques est à droite. Les charretiers devaient être bien adroits pour faire passer dans les rues parfois pavées, ces imposantes décorations. Quelques années plus tard, la hauteur des chars fut revue à la baisse, les fils électriques et télégraphiques barrant le passage…